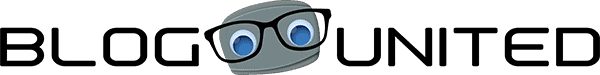Les premiers cinéastes étaient confrontés à un problème : comment capturer l’horreur de la guerre sans se faire tuer. Leur solution : truquer les séquences.
Qui le premier a eu l’idée de construire une pyramide, ou de se servir de la poudre à canon comme d’une arme ? Qui a inventé la roue ? D’ailleurs, qui a pensé à ramener une caméra sur le champ de bataille pour tirer profit des tristes réalités de la guerre ? L’Histoire ne répond à aucune des trois premières questions, et n’est pas certaine concernant la quatrième, pourtant les premiers films de guerre ne peuvent dater de bien avant 1900.
Ce que l’on peut dire sans trop s’avancer, c’est que la plupart des premières séquences nous en apprennent peu sur la guerre telle qu’elle était menée à l’époque, mais beaucoup plus sur l’ingéniosité des cinéastes. Car tout ou presque était mis en scène ou truqué, créant un modèle reproduit des années durant avec plus ou moins de succès.
Les rares historiens à s’être penchés sur la préhistoire de la photographie de guerre semblent être d’accord sur le fait que les premières séquences filmées en zone de guerre datent de la guerre gréco-turque de 1897, et sont attribuées à Frederic Villiers, correspondant de guerre vétéran d’origine britannique.
Il est difficile de dire à quel point il a su tirer parti d’une guerre si obscure, et bien que Frederic Villiers, connu pour son égocentrisme, ait décrit son expérience dans des détails parfois difficiles à croire, il n’y plus aucune trace de ses dites séquences. Il est néanmoins certain que le vétéran anglais était un reporter expérimenté et a couvert une douzaine de conflits en 20 ans de métier, et se trouvait certainement en Grèce pour au moins une partie de la Guerre de Trente Jours.
Frederic Villiers étant aussi un artiste de guerre borné mais prolifique, l’idée de filmer la guerre à l’aide d’une caméra de cinéma lui est sans doute venue toute seule.
"Regardez la tête !"
Si c’est le cas, cette notion n’est pas apparue évidente à tout le monde en 1897 ; quand Frederic Villiers est arrivé à la base de Volos à Thessalie, traînant derrière lui un cinématographe et une bicyclette, il était le seul caméraman à couvrir cette guerre. Selon ses dires, il aurait réussi à photographier le combat d’une longue distance, mais les clichés étaient décourageants, essentiellement car la vraie guerre ne ressemblait que très peu à l’imagerie romantique que s’en faisait le public amateur de l’actualité filmée.
"Il n’y avait aucun son de clairon" s’est plaint le journaliste en rentrant, "ni roulement de tambour, aucun étalage de drapeaux ou de musique militaire de quelque sorte… Tout avait changé dans cette guerre moderne, à mes yeux cette façon de se battre était sans pitié et sans intérêt, ça m’a déprimé pendant plusieurs semaines."
Frederic Villiers aspirait à des images plus viscérales, il a obtenu ce qu’il voulait grâce à un mode de ressources classique, il a traversé la frontière turque pour s’assurer un entretien privé avec le gouverneur ottoman Enver Bey, qui lui a permis d’utiliser un passage sécurisé jusqu’à la capitale grecque Athènes, beaucoup plus proche des combats.
"Non content de cet accord", écrit Stephen Bottomore, grande autorité des premiers films de guerre, Villiers a demandé des informations confidentielles a gouverneur : "Je veux savoir où et quand aura lieu la prochaine bataille. Les Turcs vous prendrez l’initiative car pour l’instant les Grecs ne peuvent que se défendre."
Bien sûr, Enver Bey a été surpris par sa demande. Il a regardé Villiers un moment, puis a fini par dire : "Vous êtes un Anglais, je peux vous faire confiance. Laissez moi vous dire ceci… Prenez ce bateau à vapeur… Jusqu’au port de Domokos, et faites en sorte d’être là-bas au plus tard lundi midi."
Armé de cette information exclusive (le récit de la guerre vue par Villiers continue), il est arrivé à Domokos "le jour et l’heure exacts pour entendre le premier coup tiré par les Grecs en direction de l’infanterie Moslem qui traversait les plaines de Pharsala". Il a tourné quelques scènes de combat.
Même si le caméraman est resté curieusement modeste concernant les fruits de son travail, on peut raisonnablement conclure que ses bandes auraient, dans le meilleur des cas, peu témoigné de l’action qui s’en est suivie.
Cette conclusion apparaît implicite dans un fragment rescapé et révélateur : le propre récit de Villiers, indigné d’avoir été mis sur le carreau par un audacieux rival. Bottomore note :
"Les images étaient fidèles, mais elles manquaient d’attrait cinématographique. Quand il est revenu en Angleterre, il s’est rendu compte que ses images ne valaient pas grand-chose sur le marché du film. Un jour, un ami lui a dit que le soir d’avant, il avait vu de magnifiques images de la guerre grecque. Villiers en a été surpris, il était certain d’avoir été le seul photographe à couvrir cette guerre. Il n’a pas tardé à comprendre, à l’écoute du compte-rendu, que son ami ne parlait pas de son travail."
"Trois Albanais approchaient d’une petite maison, le long d’un chemin poussiéreux à droite de l’écran. Ils ont ouvert le feu en s’approchant ; on pouvait voir l’impact des balles sur le stuc de la maison, puis un des Turcs a forcé la porte avec la crosse de son fusil, est entré puis est ressorti avec une jolie domestique athénienne dans ses bras… Peu après un vieil homme, de toute évidence le père de la jeune fille, s’est précipité dehors à la rescousse de sa fille, alors le second Albanais a tiré de sa ceinture un yataghan et a décapité le gentilhomme ! Mon ami en transe s’est écrié : "Regardez la tête, elle roule en direction de l’écran. C’est ça qu’on veut"."
Méliès le trouble-fête
Bien qu’il l’ait sans doute toujours ignoré, Frederic Villiers s’est fait damer le pion par l’un des plus grands génies du cinéma, Georges Méliès, un Français dont on se souvient aujourd’hui pour son court-métrage à effets spéciaux de 1902, Le Voyage dans la lune.
Cinq ans avant ce triomphe, Méliès avait été, au même titre que Villiers, inspiré par le potentiel commercial de la vraie guerre en Europe. À l’opposé de Villiers, il était plus proche de son jardin que du front, mais grâce à son sens du spectacle, le Français a néanmoins vaincu son adversaire présent sur le terrain, et a même tourné quelques scènes censées représenter des gros plans d’une bataille navale théâtrale. Ces dernières scènes, retrouvées il y a quelques années par l’historien John Barnes, sont remarquables grâce à l’innovation du plateau articulé, une section pivotante conçue pour faire croire que le bateau de Méliès naviguait dans une mer déchaînée, méthode à peine modifiée et toujours utilisée sur les plateaux de nos jours.
Frederic Villiers, non sans humour, a lui-même admis à quel point il était difficile pour un caméraman sur le terrain de rivaliser avec un truquiste futé. Le problème, a-t-il expliqué à son ami exalté, c’était la lourdeur de la caméra contemporaine :
"Il faut installer un trépied… Et faire les mises au point avant de pouvoir déclencher l’appareil. Puis il faut tourner la poignée avec volonté, comme pour un moulin à café, sans précipitation ni excitation. C’est tout le contraire d’un appareil instantané, comme les appareils jetables Kodak. Maintenant imaginez cette scène que vous venez de me décrire si vivement. Imaginez l’homme en train de moudre du café, dire avec conviction : "Maintenant M. l’Albanais, avant de décapiter le vieillard venez un peu plus près, oui, mais un peu plus vers la gauche, s’il vous plait. Merci. Maintenant, ayez l’air aussi sauvage que possible, et tranchez sa tête". Ou :"Vous, l’Albanais numéro 2, faites en sorte que la coquine baisse un peu son menton et que ses coups de pieds soient aussi féminins que possible." "
Le même résultat, c’est-à-dire d’authentiques scènes de combats filmées de loin supplantées dans les salles de cinéma par des images truquées, remplies d’action et plus viscérales, a été obtenu quelques années plus tard lors de la Révolte des Boxeurs en Chine et la Guerre des Boers, qui a opposé les forces britanniques aux fermiers afrikaners.
Le conflit en Afrique du Sud a mis en place un modèle que la photographie de guerre a suivi pendant des décennies (et qui a été répété dans le célèbre premier long-métrage documentaire sur la guerre, la réputée production de 1916 La Bataille de la Somme, qui mixait de vraies séquences des tranchées avec de fausses scènes de combats filmées dans les environs, grâce au concours d’une école de mortier tapie derrière les lignes. Le film fut acclamé sans réserve et fit salle comble pendant des mois.)
Rétrospectivement, certains ont avoué avoir eu recours à l’artifice. R.W. Paul, producteur d’une série de courts-métrages qui couvraient le conflit d’Afrique du Sud, n’a pas prétendu avoir tourné ses séquences en zone de guerre, en se contentant de déclarer qu’elles avaient été "arrangées sous la supervision d’un officier militaire expérimenté du front". D’autres non.
William Dickson, de la British Mutoscope and Biograph Company, a voyagé jusqu’au Veld et a produit ce que Barnes décrit comme "des séquences qui peuvent être considérées comme réelles – des troupes dans un camp et en déplacement – bien qu’il soit évident qu’une grande partie de ces séquences ait été mise en scène. Les soldats britanniques étaient habillés avec des uniformes Boer pour reconstruire les escarmouches. On raconte que le commandant en chef britannique, Lord Roberts, consentit à être filmé avec la totalité de son équipe, allant jusqu’à exposer sa table sous le soleil pour faciliter la tâche de Dickson".
Concernant les premières productions cinématographiques, il n’est pas très difficile de faire la distinction entre les séquences truquées et les scènes authentiques.
Fonctionnant typiquement par gros plans, les reconstitutions sont à même de trahir la réalité. Barnes, dans son étude Filmer la Guerre des Boers, note qu’il est caractéristique que "l’action, à la manière des films d’actualité de la période, s’y déroule loin de la caméra, bien que se présentant en direction de celle-ci : c’est l’idée des scènes de rue où les piétons et les automobiles se déplacent en fonction de l’axe de la lentille plutôt qu’en suivant celui du champ de vision, comme le ferait un acteur sur une scène de théâtre".
Bien sûr, impossible de ne pas penser qu’il s’agit là d’une tentative délibérée de la part des réalisateurs de duper le public, mais il serait pourtant trop facile de les juger. Après tout, comme l’a souligné D.W. Griffith, un autre des grands pionniers du cinéma, un conflit aussi énorme que la Première Guerre mondiale "dépasse trop l’entendement pour qu’on puisse y sentir réellement le drame qui s’y noue. Personne ne peut décrire ce que représente ce conflit. C’est aussi absurde que de se lancer pour défi de décrire, d’une manière parfaite et exhaustive, un océan… ou la voie lactée… alors même que personne n’a jamais vu plus d’un centième de leur immensité ".
Bien sûr, les difficultés que Griffith a décrites, et que Frederic Villiers et tout ceux qui suivirent son chemin en Afrique du Sud et en Chine au tournant du siècle ont effectivement pu rencontrer, ne représentent rien comparées aux problèmes auxquels se confrontent, même aujourd’hui encore, les réalisateurs voulant mettre sur pellicule des batailles maritimes : la tâche est connue pour être particulièrement coûteuse.
Si le travail pionner de Georges Méliès sur la guerre gréco-turque a pu établir les normes générales sur le documentaire de guerre, dans le domaine des batailles navales, les images les plus intéressantes – et peut-être également les plus drôles, malgré elles – ayant survécu au XXe siècle sont celles censées montrer la victoire de la flotte américaine durant la guerre hispano-américaine de 1898.
Précisons-le clairement : ces séquences reconstituées sont moins à voir comme une imposture intentionnelle et malveillante que comme une manière créative de palier cette frustration que produit l’impossibilité d’obtenir le film authentique des batailles réelles ; ou du moins comme une manière d’être, en quelque sorte, malgré tout, le plus proche possible de l’action. C’est le cas du film qui ici nous intéresse. Celui-ci a été produit par le fondateur du prolifique studio American Vitagraph de Brooklyn, Albert Smith. C’est lui qui, d’après les sources officielles, décida d’abord de le tourner sur place, à Cuba.
The Battle of Santiago Bay
Malheureusement, il se rendit vite compte que ses caméras, de mauvaise facture, ne pouvaient pas filmer à longue distance des séquences de qualité suffisante pour être utilisées. Il retourna donc aux États-Unis avec pour seules prises de vue des paysages. Puis, peu de temps après, il apprit que de l’autre côté du pays, aux Philippines, la flotte américaine avait triomphé sur la marine espagnole, largement dépassée.
C’était la première fois que des escadrons américains avaient gagné une bataille d’aussi grande importance depuis la Guerre civile, et c’est pourquoi il était absolument nécessaire pour Smith, ainsi que pour son partenaire, James Stuart Blackton, de réaliser un film à ce sujet : il était pour eux évident que des séquences ayant capturé la destruction des navires espagnols pourraient intéresser un grand nombre de gens.
Mais comment faire ? La solution trouvée par Smith pour se procurer ces images – solution qu’il décrit dans ses mémoires – était aussi ingénieuse qu’elle demandait peu de moyens techniques :
"À l’époque, des marchands vendaient de grandes photographies représentant les bateaux de guerre qui composaient la flotte américaine et la flotte espagnole. Nous avons acheté ces photographies, puis avons découpé les bateaux et jeté le reste des photos. Sur une table, renversée, nous avons placé une grande bâche et nous l’avons remplie d’eau. Quelques centimètres de profondeur, pas plus. Pour faire tenir les navires que nous venions de découper, nous les avons cloués à des morceaux de bois. On a ainsi formé une sorte de petite cloison en-dessous de chaque bateau, dans lesquelles on avait placé quelques pincées de poudre à canon – trois pincées pour être précis – c’est-à-dire ni trop peu ni trop assez : le minimum pour recréer un événement de cette envergure.
Pour l’arrière-plan, nous avons barbouillé quelques nuages sur un carton bleu. Pour chacun de ces navires, avant de les poser, là, nonchalamment, dans notre baie – ou dans notre flaque plutôt –, nous leur avons attaché un fil fin pour nous permettre par la suite de les mouvoir devant la caméra, au moment opportun, et dans le bon ordre.
Nous avions besoin de quelqu’un pour souffler de la fumée sur la scène, mais nous ne pouvions pas demander à n’importe qui, pour préserver le secret. Nous avons donc fait appel à la femme de Blackton. Elle s’était en fait elle-même portée volontaire – à une époque où il était très inhabituel qu’une femme fume. Et un garçon de notre bureau, gentillet, se proposa également pour essayer le cigare, ce qui nous arrangeait : nous avions besoin d’un certain volume de fumée.
Nous avons également imbibé un morceau de coton d’alcool, et nous l’avons attaché à un dernier fil, suffisamment fin lui aussi pour qu’il reste invisible à l’œil nu. Il permettait à Blackton, caché derrière la table, de faire exploser à distance les monceaux de poudre. La bataille pouvait alors commencer. Mme Blackton, fumant, toussant, laissait échapper une fine brume de sa cigarette : Jim avait mis au point avec elle la chronologie la plus précise possible pour qu’elle souffle sur sa cigarette au moment même de l’explosion, ou du moins ni trop tôt ni trop tard.
L’équipement cinématographique de l’époque était suffisamment imparfait pour dissimuler le caractère rudimentaire de notre petit travail, et puisque le film ne durait que deux minutes seulement, personne n’avait le temps d’y porter un regard critique. Le film rencontra un large public pendant plusieurs semaines. Et tant mieux : Jim et moi nous sommes sentis moins coupables lorsque nous avons pris conscience de toute l’excitation et de tout l’enthousiasme qu’il y avait autour de notre film, The Battle of Santiago Bay."
Déconstruire le mythe
De manière peut-être surprenante, le film de Smith (dont on a, il faut croire, perdu toutes les copies) a effectivement dupé le public de l’époque, encore peu habitué au cinéma – à moins qu’il n’ait été trop poli pour faire mention de ses défauts, pourtant manifestes, et ce d’autant plus quand on sait qu’à la même époque, existaient des scènes contrefaites un peu plus convaincantes, et notamment celles dirigées par un rival, Edward Hill Amet.
Le réalisateur, venu de Waukegan, dans l’Illinois, a voulu, malgré l’interdiction de voyager à Cuba, retranscrire une autre bataille du conflit hispano-américain. Pour ce faire, il a bien sûr contourné les contraintes matérielles. Il s’est ainsi mis à fabriquer un ensemble de maquettes des troupes, très détaillées, au format 1:70, avant de les faire flotter dans un réservoir long de presque dix mètres, construit à l’air libre au sein de son jardin dans le Comté de Lake.
Contrairement à Smith, dont le travail était quelque peu précipité par les événements, le tournage d’Amet s’est méticuleusement planifié. Ses maquettes étaient beaucoup plus réalistes. Elles étaient toutes soigneusement construites par rapport aux photographies et aux plans des vrais bateaux, au point que chacune d’entre elles était équipée de cheminées et de canons, contrôlées par un panneau électrique.
Ainsi, le film issu de ce dispositif, s’il a incontestablement l’air, pour un public moderne, très amateur, était néanmoins, pour les standards de l’époque, considéré comme réaliste. Preuve en est l’observation de Margarita De Orellana : "Selon les ouvrages de l’histoire du cinéma, le gouvernement espagnol a acheté une copie de ce film pour le conserver dans les archives militaires, à Madrid. Il était manifestement convaincu de son authenticité."
Si nous devons retenir une leçon de cette histoire du cinéma, ce n’est pas que la caméra peut mentir, ni même qu’elle le fait régulièrement : c’est qu’elle ment depuis le jour même de son invention.
La reconstitution des scènes de batailles est née avec la photographie de guerre. Mathew Brady en faisait déjà durant la Guerre civile américaine. Et même plus tôt, en 1858, à la suite de la révolte des cipayes, le photographe Felice Beato, véritable précurseur, créait des reconstitutions particulièrement dramatisées, et est notamment connu pour éparpiller des crânes humains d’Indiens au premier plan de ses photographies de Sikandar Bagh, histoire de mettre en valeur l’image.
Ce qu’il y a, peut-être, de plus intéressant dans tout cela, c’est la question de la réception : dans quelle mesure le public accepte-t-il volontiers ces images comme étant des émanations de la réalité ? La plupart des historiens n’hésitent pas à affirmer que les publics de ces fausses photographies et de ces reconstitutions cinématographiques étaient remarquablement naïfs, voire bonnes poires.
Un exemple connu n’est autre que la fameuse séance du premier film des frères Lumière, L’arrivée d’un train à La Ciotat, qui montre un train entrant dans une gare, la caméra étant placée sur une plateforme, directement en face du train. La légende veut que les spectateurs fussent tellement paniqués par la scène – le train arrivant si vite et les gens étant incapables de distinguer la réalité de la fiction – qu’ils étaient sûrs que le train allait d’une seconde à l’autre sortir de l’écran pour s’écraser dans la salle.
Cependant, des recherches plus récentes ont cherché à déconstruire le mythe, suggérant notamment que la réception originale du film en 1896 s’est confondue dans l’imaginaire collectif avec la panique créée en visionnant, dans les années 1930, les premières images 3D créées à partir de la même séquence. Mais au vu du manque de sources, il reste difficile de connaître avec précision la manière dont le public a vécu la réception du film des frères Lumière.
Cependant, il est certain qu’aujourd’hui, ce qui impressionne le plus ceux qui regarderont ces tout premiers documentaires de guerre, c’est leur caractère parfaitement artificiel et ridiculement irréaliste. Mais, selon Bottomore, l’audience de 1897 avait déjà des sentiments partagés concernant les créations de Georges Méliès :
"Certes, quelques personnes pouvaient croire que certains des films étaient bel et bien authentiques, et surtout lorsque le maître de cérémonie les présentait tels quels. Mais d’autres spectateurs avaient des doutes à ce sujet… L’un des meilleurs commentaires quant à la nature ambiguë des films de Méliès vient probablement d’un journaliste contemporain, qui qualifie ces films de “merveilleusement réalistes“, indiquant par là même déjà la valeur artistique de ces objets artisanaux."
Mais qu’importe le caractère réaliste ou irréaliste des films de Méliès ou des autres. Ce qui est intéressant, c’est que ces premiers réalisateurs développèrent des techniques que leurs successeurs, bien mieux équipés, allaient à nouveau utiliser pour filmer de réelles scènes de guerre – et alimentant par là même la demande faite pour les séquences de combat, dont la violence a grandement participé à la gloire du métier de journaliste.
Les reportages modernes doivent beaucoup aux précurseurs du cinéma, et tant que la dette n’est pas remboursée, le souvenir de Pancho Villa continuera à hanter la profession.
Source : Resterenvie.com

Fondateur de Blog-United et d’autres médias en ligne, Yvan est un grand passionné du web. Blogueur depuis plus de 15 ans, il est fan de séries, de jeux vidéo, d’Art, de sport ou encore de nouvelles technologies.